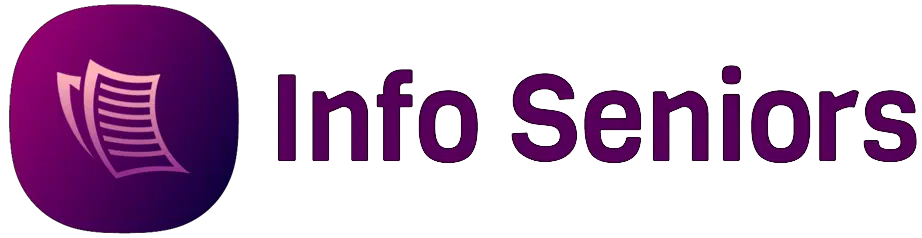Sortir de l’hôpital n’entraîne pas systématiquement le retour complet à l’autonomie. Pour de nombreuses personnes, la convalescence à domicile demande un accompagnement temporaire afin d’assurer la sécurité, un certain confort et la continuité des soins. Plusieurs dispositifs existent, dont l’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH), pour faciliter cette étape et favoriser un maintien à domicile dans de bonnes conditions.
Résumé en trois points clés :
A lire également : Les solutions de logement idéales pour les seniors, adaptées à leurs besoins spécifiques
- Une coordination hospitalière est mise en place dès l’admission pour prévoir les besoins à la sortie, en collaboration avec le service social.
- L’ARDH propose un financement plafonné à 1 800 €, avec une contribution financière variable selon les ressources.
- Cette aide est temporaire (jusqu’à trois mois) et couvre des services modulables comme l’aide à domicile, le portage de repas ou certaines adaptations du logement.
Les étapes pour obtenir une aide à domicile
1. Coordination hospitalière dès l’admission
Lors de l’entrée à l’hôpital, il est utile de mentionner tout besoin en assistance pour le retour à domicile auprès du service social de l’établissement. Cette prise en charge précoce permet d’activer les dispositifs existants et de préparer les démarches administratives avant la sortie. Le service social facilite la liaison entre équipes médicales et organismes d’aide à domicile, ce qui contribue à la continuité des soins et à la préparation d’un plan d’aide adapté.
2. Évaluation des besoins
Une évaluation de la situation est menée en utilisant la grille nationale AGGIR, qui mesure le niveau de dépendance (GIR 5 ou 6 pour bénéficier de l’ARDH). Cette analyse est nécessaire pour adapter les solutions au degré d’autonomie et aux besoins de la personne : soins infirmiers, assistance d’un auxiliaire de vie, adaptations du logement (barres d’appui, sièges de douche), équipements médicaux comme un lit médicalisé ou encore la téléassistance. Cette étape oriente l’accès à une aide à domicile après hospitalisation ajustée au profil de la personne.
Lire également : Quelle prise en charge pour un senior à Mandelieu-la-Napoule ?
3. Constitution du dossier ARDH
Le dossier, une fois constitué, est envoyé à la Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) par l’établissement hospitalier. Cette démarche rapide facilite le traitement de la demande et évite des interruptions de services lors du retour au domicile. La réactivité administrative est ici un aspect apprécié : prévoir les démarches en amont aide souvent à vivre la transition de manière plus sereine.
4. Élaboration d’un plan personnalisé
Selon les conclusions de l’évaluation, un plan d’aide est construit. Il peut comprendre :
- des prestations comme l’aide-ménagère, l’aide à la toilette, l’accompagnement pour les courses, la préparation ou le portage de repas,
- des modifications du logement (installation de barres, rehausse WC) et la fourniture d’équipements médicaux,
- le recours à un auxiliaire de vie, un infirmier libéral ou à des services de transport adapté.
Pour trouver des professionnels fiables, il est conseillé de consulter les agences d’aide à domicile Adhap.
5. Suivi post-retour
Après le retour, le suivi est réalisé par un infirmier coordinateur ou un membre du service social, en lien avec le médecin traitant et les intervenants à domicile. Cette coordination sert à ajuster les prestations selon l’état de santé et à maintenir une continuité dans les soins à domicile, réduisant ainsi les risques de réhospitalisation grâce à des visites régulières.
Témoignages et expériences vécues
Témoignage de Simone, 72 ans :
« Après ma chute, l’infirmière à domicile m’a aidée à retrouver de la confiance. Grâce au portage de repas, j’ai pu continuer à vivre chez moi. »
Ce type de récit souligne l’intérêt de l’accompagnement humain pendant la convalescence. Les auxiliaires de vie et les professionnels à domicile jouent un rôle appréciable dans le maintien au domicile, apportant soutien psychologique, assistance quotidienne et continuité des soins.
Aspects financiers et critères d’exclusion
1. Plafond et participation financière
L’ARDH prévoit une enveloppe de dépenses plafonnée à 1 800 € couvrant diverses prestations : aide à domicile, adaptation du domicile, équipements essentiels, téléassistance ou portage de repas. La contribution de l’assuré oscille entre 10 et 75 % selon ses ressources, tandis que le reste est pris en charge par la caisse de retraite.
2. Critères d’exclusion
L’ARDH n’est pas cumulable avec certaines aides publiques telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou la Majoration pour tierce personne (MTP). Il est donc nécessaire de vérifier ses droits avant de procéder à toute demande afin d’éviter des erreurs de cumul.
3. Vérification des clauses d’assurance complémentaire
Il est intéressant de consulter sa mutuelle santé ou d’autres contrats assurantiels : certains peuvent proposer une aide supplémentaire après la période couverte par l’ARDH, ou offrir des prestations comme l’ergothérapie, le transport sanitaire ou l’équipement médical spécialisé. Cette vérification participe à un accompagnement plus étendu et à une meilleure organisation de la période post-hospitalisation.
Pour mémoire, l’ARDH agit comme un soutien temporaire précieux entre la sortie hospitalière et l’autonomie retrouvée. Si elle est anticipée et bien coordonnée, l’aide à domicile contribue fortement à sécuriser la convalescence dans un cadre familier et adapté aux besoins de chacun.